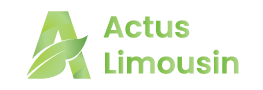En début de semaine, le centre de détention d’Uzerche a exceptionnellement ouvert ses portes à une vingtaine d’acteurs économiques et politiques de la Haute-Vienne et de la Corrèze. Objectif : leur présenter le travail pénitentiaire, une facette méconnue de l’univers carcéral.
Pour la vingtaine de visiteurs qui ont répondu présents à l’invitation lancée ce jour-là par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Nouvelle-Aquitaine, cette incursion dans un établissement carcéral est une première. Benoît Sender, directeur administratif et financier du centre, commence donc la visite par une petite présentation.
Implanté sur un site de 23 hectares, la prison d’Uzerche est le seul centre de détention de Corrèze et dispose de 25 000 m² de bâtiments pour héberger environ 600 hommes majeurs condamnés par la justice à des peines supérieures à deux ans. « Ici, les personnes détenues bénéficient d’une certaine autonomie, notamment dans des secteurs comme la cuisine ou la buanderie » explique Benoît Sender, directeur administratif et financier du centre. Cette autonomie relative s’inscrit dans une philosophie de détention orientée vers la préparation à la réinsertion.

Le travail en détention : des bénéfices partagés
Caroline Prat, responsable de la relation aux entreprises, nous détaille les deux principales modalités du travail en détention :
- le service général (60% de l’activité) représente toutes les missions effectuées au profit de l’établissement lui-même : entretien des locaux, maintenance, espaces verts, cuisine…
- En parallèle, 40 % du travail est réalisé pour le compte d’acteurs économiques extérieurs. Qu’elles soient industrielles, artisanales ou de service, ces activités s’inscrivent dans une politique gouvernementale ambitieuse : atteindre 50 % de personnes détenues en activité rémunérée (travail ou formation professionnelle) d’ici fin 2026.
Un levier puissant contre la récidive
« Cette insertion professionnelle est un véritable levier de prévention de la récidive » souligne Caroline Prat, chiffres à l’appui. « Une sortie sans accompagnement entraîne 59 % de récidive dans les cinq ans, contre 30 % lorsque la sortie est accompagnée. »
Le défi est d’autant plus grand que la population carcérale présente bien souvent un profil socioprofessionnel particulièrement fragile : 80 % des détenus ont un niveau inférieur au baccalauréat, 50 % n’ont aucun diplôme, et un certain nombre sont en situation d’illettrisme. « Pour beaucoup, travailler en détention constitue une première expérience professionnelle. C’est quelque chose de vraiment nouveau pour eux » précise-t-elle.
Une source de revenus conditionnée par une sélection rigoureuse
Malgré ces difficultés, l’envie de travailler reste forte parmi les détenus. Car s’il constitue un incontestable vecteur d’insertion, le travail permet également aux détenus de percevoir une rémunération, utilisée pour participer à la vie familiale, indemniser les victimes et améliorer leur quotidien en détention.
« Environ 70 % des personnes incarcérées demandent à travailler, mais toutes les candidatures ne peuvent pas être retenues » indique Benoît Sender. Les postulants sont profilés avant de passer en commission pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement vers l’emploi.
Un modèle gagnant-gagnant pour les entreprises
Le travail pénitentiaire est présenté comme une opportunité pour les entreprises :
- Une responsabilité sociétale renforcée, en accompagnant des personnes vers un emploi et une réinsertion durable,
- Une production de proximité qui limite l’empreinte environnementale,
- Des démarches administratives réduites,
- Des coûts maîtrisés avec une rémunération horaire fixée à 45 % du SMIC, la mise à disposition gratuite des locaux, l’absence de congés payés et une équipe toujours sur place
- Les entreprises soucieuses de valoriser leur engagement peuvent afficher le label PePs (Produit en Prison), créé en 2020, qui garantit des conditions de fabrication responsables et inclusives pour les produits réalisés en détention.
Témoignage : quand la boulangerie devient un outil de réinsertion
Laurent Saute, artisan boulanger, a choisi de développer une activité au sein du centre de détention. De 3 h à 7 h du matin, il travaille dans sa boulangerie en ville, puis de 7 h 30 à 13 h 30, il encadre la production au sein de la prison. « J’ai été séduit notamment par la qualité des investissements, avec un très beau laboratoire » explique-t-il. Il a donc postulé pour reprendre la concession de boulangerie qui était vacante au sein de l’établissement.
Sous sa direction, six détenus confectionnent quotidiennement 600 baguettes et autant de viennoiseries, destinées à la consommation locale. « Avant, le pain arrivait chaque matin en camion depuis Poitiers, avec une empreinte carbone bien supérieure » souligne-t-il. Mais ce qui rend particulièrement fier M. Saute, c’est la dimension formative de son intervention : « Tous mes apprentis vont passer leur CAP ».

Benoit Sender insiste sur ce point : « C’est exactement le même diplôme que celui qui se fait à l’extérieur, sauf qu’il peut être décroché en 3 mois contre 10 mois traditionnellement. » Cette accélération est facilitée par l’organisation du temps : production de pain le matin, cours l’après-midi grâce à l’unité locale d’enseignement assurée par du personnel de l’Éducation nationale.
Les résultats de cette initiative dépassent le cadre strictement professionnel. « Une personne était vraiment en mode dépressif avant de commencer et a retrouvé du sens grâce à cette activité, » raconte M. Saute. Plus concret encore : il a proposé de recruter un des détenus à sa sortie, tandis qu’un autre a déjà une promesse d’embauche ailleurs.
La parole des premiers concernés
Pour des raisons évidentes de confidentialité, il n’était pas possible d’interroger directement les détenus lors de cette visite, quelques témoignages recueillis par l’administration sont éloquents : « Avec ce que je gagne, je peux indemniser la victime et aider financièrement ma famille. » « Je suis fier du travail que je fais en prison, et ça me donne de l’espoir pour l’avenir. » « J’ai retrouvé un peu de dignité, je me sens utile. »
Au-delà du travail : les TIG, une autre voie de réinsertion
La matinée se poursuit avec une présentation du dispositif des Travaux d’Intérêt Général (TIG), qui correspondent à un nombre d’heures de travail effectuées suite à un jugement, généralement pour des primo-délinquants coupables de délits mineurs. Là encore l’objectif reste la prévention de la récidive. « En général, ils sont condamnés à 120 heures de travaux » explique Bruno Badefort, « le fait d’effectuer ce type de travail peut les remettre dans le droit chemin assez vite. »
Ces personnes sont accueillies principalement par des mairies ou des associations comme Emmaüs ou les Restos du Cœur mais un appel à candidature est lancé pour trouver d’autres structures potentiellement intéressées.
Comment devenir partenaire ?
Pour les entreprises séduites par le concept, une procédure claire est établie. « L’activité développée doit pouvoir être réalisée dans le respect des règles de sécurité de la détention et prendre en compte la configuration des locaux mis à disposition » précise Benoît Sender.
Un appel à candidatures est diffusé pour identifier les partenaires économiques potentiels, qui seront ensuite départagés selon plusieurs critères : compatibilité avec les contraintes de l’établissement, capacité à recruter, former et encadrer techniquement les opérateurs, et proposition d’une activité pérenne ou à minima récurrente. Les entreprises intéressées sont invitées à se manifester auprès de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Nouvelle Aquitaine et tout particulièrement de Caroline Prat.