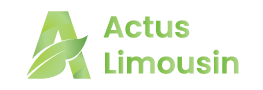A Pompadour, Bernadette Besse perpétue une tradition familiale vieille de plus de 70 ans. Cette exploitante agricole, « née dans la pomme », dirige avec son époux un (petit) domaine de 13 hectares de vergers. Et son entreprise familiale illustre parfaitement l’évolution spectaculaire qu’a connue l’arboriculture française depuis les années 1950.
Une exploitation familiale qui a su s’adapter
L’histoire de cette exploitation débute en 1954, quand le père de Bernadette Besse plante ses premiers pommiers. À l’époque, pas de « Golden Delicious » : on cultivait principalement des variétés rouges, notamment la « Winter Banana », une pomme très douce destinée au marché nord-africain. Mais l’indépendance de l’Algérie a bouleversé la donne. « Le fruit ne correspondait pas au goût des Européens, trop doux, manquant d’acidité », explique Madame Besse. C’est alors qu’arrive la Golden, une variété d’origine américaine qui va révolutionner la pomiculture limousine.
Aujourd’hui, l’exploitation compte 13 hectares de vergers de pommes, un demi-hectare de poires et même 7 hectares de cassis industriels destinés à Andros. Cette diversification n’est pas anodine : elle répond aux aléas économiques et climatiques qui touchent régulièrement la filière pomme.

Une révolution technique permanente
Mais l’évolution la plus spectaculaire concerne les formes de conduite des arbres. Finis les pommiers « de plein vent » à la silhouette volumineuse, qui nécessitaient des échelles pour la récolte. Dans les années 1970, Jean-Marie Lespinasse, un ingénieur de l’INRA, invente l’axe central. L’idée est d’avoir un aspect plutôt en sapin, avec des branches plus larges au bas de l’arbre pour laisser passer la lumière. Cette technique crée un « mur fruitier », qui facilite considérablement toutes les interventions.

Autre révolution : l’arrivée des « palox » en 1974, ces grosses caisses en bois qui contiennent 340 kg de pommes ont remplacé les traditionnelles cagettes et grandement contribué à réduire la pénibilité de la cueillette. Aujourd’hui, la récolte se fait directement dans ces contenants, avec des systèmes de wagonnets et de plateformes qui éliminent le port de charges lourdes.
Le cycle de la pomme, au rythme des saisons
Une année de pomiculteur commence après la récolte, au mois d’octobre. Premier chantier : replier les filets anti-grêle, un travail titanesque qui demande 100 à 150 heures par hectare. Ces protections sont devenues indispensables depuis 1993, date à laquelle les assureurs ont abandonné la couverture grêle après une année catastrophique.

De décembre à avril, c’est la taille, 180 heures par hectare minimum. L’opération est d’abord mécanique avec un lamier qui donne le gabarit, suivit d’une taille manuelle pour sélectionner les branches fructifères. L’objectif est d’essayer d’en conserver une vingtaine, bien réparties. Le printemps marque le début de la protection sanitaire, et la surveillance commence dès l’apparition des premiers organes verts. Les traitements se font sur modèles prévisionnels fournis par des techniciens.
Des défis sanitaires et environnementaux
La tavelure reste l’ennemi numéro un du pomiculteur. Ce champignon, qui provoque des taches noires sur les fruits, se développe selon des conditions précises de température et d’humidité, et « si vous ratez le délai d’intervention, c’est l’explosion et c’est incontrôlable », prévient Bernadette Besse.
Pour le carpocapse, ce papillon dont les larves percent les fruits, des solutions combinent désormais biocontrôle et opérations ciblées. Des diffuseurs de phéromones — sous la forme de petits bâtons souples qu’on insère dans les branches — servent à désorienter les mâles en émettant l’hormone sexuelle femelle. Privés de repères olfactifs, ils ne trouvent plus leurs partenaires pour s’accoupler. A cette méthode naturelle viennent s’ajouter des traitements plus spécifiques lors des pics de vol, identifiés grâce aux modèles prévisionnels.

Mais c’est le puceron cendré qui pose aujourd’hui le plus de problèmes. Avec l’interdiction (salutaire) des néonicotinoïdes, les producteurs français se trouvent en « distorsion de concurrence » face à leurs voisins européens. Les auxiliaires naturels existent, comme la coccinelle, mais ils arrivent malheureusement trop tard. Les pomiculteurs espèrent donc la mise au point rapide d’une solution efficace, et sans néonicotinoïdes, pour combattre le puceron cendré.
Enfin, les défis ne s’arrêtent pas aux parasites car à cause du réchauffement climatique, une nouvelle pratique s’impose : le blanchiment des arbres au talc. Cette poudre est déposée sur les troncs et les fruits pour faire office de « crème solaire » végétale. « Tout comme nous, les pommes doivent se protéger du soleil », indique Madame Besse en montrant un fruit brûlé par le soleil. Mais le talc a cependant ses propres contraintes : difficile à appliquer, il ne reste pas longtemps et nécessite un brossage minutieux des fruits à la récolte afin d’éviter que les consommateurs ne le confondent avec des résidus de pesticides.

La récolte des pommes : un marqueur de la fin de l’été
Septembre marque l’apogée de l’année agricole avec la récolte, mais aussi son principal défi. « Le premier gros stress, c’est trouver des personnes, former une équipe », avoue Bernadette Besse. Le recrutement reste complexe et les étudiants, autrefois piliers de ces équipes, ne sont plus disponibles depuis que la rentrée à l’université se fait début septembre. L’origine des saisonniers a donc évolué et les pomiculteurs limousins trouvent leurs renforts auprès des travailleurs étrangers : Polonais, Espagnols, Portugais, Roumains, Bulgares, Marocains, Cambodgiens…

Si le travail est toujours physique, les conditions ont bien évolué. Finis le sac en jute en bandoulière et les échelles en bois ! Aujourd’hui, la cueillette se fait directement dans les palox posés sur des wagonnets que tractent les ramasseurs. Pour les parties hautes, des plateformes équipées de systèmes de roulement permettent d’évacuer les caisses vers l’arrière d’un simple bouton. Une attention particulière est portée à la conservation du pédoncule : si le fruit n’a plus sa « queue », il est déclassé automatiquement.
Après la récolte : la technologie au service de la conservation
Une fois cueillis, les fruits entament un parcours technologique sophistiqué. Chaque palette est tracée avec la date de récolte et le numéro de parcelle. À leur arrivée àla station, les pommes sont analysées pour vérifier l’absence de résidus, puis pré-calibrées par des systèmes électroniques qui évaluent qualité, couleur et grosseur.
L’innovation majeure reste la conservation en atmosphère contrôlée. Dans des chambres froides à 2-4 °C, pauvres en oxygène, les pommes peuvent se conserver une année entière. Ce procédé bloque la production d’éthylène, hormone naturelle qui accélère la maturation.
Entre changement climatique et pressions réglementaires croissantes, l’avenir s’annonce plein de défis pour la filière pomme du Limousin. Mais ces producteurs passionnés, souvent réunis en coopératives, continuent d’innover et de s’adapter, pour maintenir un savoir-faire reconnu au niveau national et une AOP « Pomme du Limousin » qui fête cette année ses 20 ans !