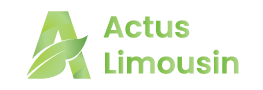Olivier Lluansi sera sur la scène de la « Biennale européenne d’histoire locale » à Tulle ce dimanche. Fin connaisseur de l’industrie française et de ses enjeux, il sillonne les territoires pour défendre une conviction : la « renaissance industrielle » française se joue au cœur des territoires, et doit servir un projet de société et un imaginaire plus enthousiasmant que « quelques points de PIB ». Rencontre avec un expert industriel qui croit encore au pouvoir des usines, des territoires et des hommes.
A 55 ans, Olivier Lluansi a déjà connu une carrière bien remplie et s’engage, en enseignant au « Conservatoire National des Arts et Métiers », dans sa « quatrième vie professionnelle ». Auparavant, cet ingénieur de formation a eu l’opportunité de « travailler à peu près à tous les étages de la puissance publique, de la Commission européenne à l’Élysée, en passant par les régions », de diriger les activités du groupe Saint-Gobain en Europe centrale et orientale et de conseiller des grandes entreprises internationales et des collectivités territoriales sur leurs stratégies industrielles.
Un parcours complet qui fait de lui l’un des plus fins connaisseurs de l’industrie française de ces dernières décennies. En 2018, il est arrivé au constat, sévère mais réaliste, que malgré la persistance du sujet en politique, des lois votées et des milliards investis, la France n’avait pas réussi à se réindustrialiser. A la recherche de réponses et de solutions, il a publié, au fil de ses travaux, plusieurs ouvrages dont : « Vers la renaissance industrielle » (2020), « Les Néos-industriels » (2022) puis « Réindustrialiser, le défi d’une génération » (2024).
Il interviendra dimanche en clôture de la « Biennale européenne d’histoire locale » de Tulle, à l’occasion d’une table ronde sur le thème « Les imaginaires passés et futurs de l’industrie ». Nous avons pu échanger avec lui sur le passé et l’avenir de l’industrie française, la perception assez négative qu’en a encore le grand public, et sur les diagnostics et les solutions qu’il a développé dans ses ouvrages après une dizaine d’années de réflexion sur ce sujet complexe de la réindustrialisation de la France.
A la source des maux : l’idée de « post-industrialisation »
Avant de parler de la réindustrialisation, petit retour à la source du problème : « Dans les années 1970, après les chocs pétroliers, la France et l’élite française basculent dans ce qu’on appelle la « post-industrialisation », avec comme idée qu’un pays c’est d’abord agraire, puis après c’est industriel, et enfin c’est tertiaire. » explique-t-il. En France, cette idée conduira à la vogue du concept de « fabless », des entreprises sans usine qui pensent leurs produits mais sous-traitent la production dans des pays où le coût de la main d’œuvre est inférieur.
« Ça a été un choix politique autour de cette idée qu’un pays ça allait dans ce sens, et donc que la production s’était fait pour les pays « low cost ». La réalité, même de pays très proches autour de nous, n’est pas du tout celle-là. L’Allemagne n’est pas un pays « low cost », elle a une densité d’industries qui est deux fois plus forte que nous. La Suisse, c’est pas un pays « low cost » non plus, et son industrie c’est 19 % dans le PIB, deux fois plus que nous ! Donc, l’idée que l’industrie serait l’apanage des pays « low cost » est une idéologie qui ne s’est pas concrétisée. Aujourd’hui, on est dans une phase où il nous faut casser ce mythe.»
Le poids des imaginaires : casser le mythe du déclin
« On a expliqué aux jeunes que l’industrie, c’était les licenciements. Et aux chefs d’entreprises qu’ils feraient mieux d’aller produire au Vietnam.» Ce désamour s’est accompagné d’un retrait des industriels du débat public et de la fermeture symbolique des portes des usines et des ateliers. « Pendant quarante ans, ils ont préféré vivre cachés. Résultat : les Français continuent d’imaginer l’usine des années 1980, bruyante et polluante. »
Mais les lignes bougent : « il y a plein d’investissements qui ont été fait pour automatiser les tâches pénibles. Je ne dis pas que c’est rose, il y a toujours de la pénibilité, il y a les trois huit etc… dans certaines industries, mais c’est bien mieux que l’image que certains en ont.» Et sous l’impulsion de nouvelles générations d’entrepreneurs, les usines rouvrent peu à peu leurs portes, accueillent des scolaires et renouent avec la fierté du geste. “On commence à voir réapparaître des héros industriels, ces « néo-industriels » qui arrivent à allier la productivité, l’ancrage territorial et l’engagement environnemental. Ce sont eux qui peuvent changer l’image du secteur.”
On ne réindustrialise pas pour réindustrialiser…
Si Olivier Lluansi est fermement convaincu de la nécessité de réindustrialiser, ce n’est pas simplement pour gagner quelques points de PIB mais pour servir un projet collectif. « On ne réindustrialise pas pour réindustrialiser. Un outil productif, une industrie, cela crée certes des emplois, de la richesse mais cela sert en réalité un objectif supérieur, cela sert un projet de société. Et c’est peut-être plus important que son poids économique. Car on ne se lève pas le matin en se disant : « ah je suis très content, je vais contribuer à 0,05 points de PIB ». Et aujourd’hui, nous sommes vraiment orphelins d’un projet de société, ce qui explique peut-être pourquoi la machine est grippée. C’est aux partis politiques de définir comment pondérer quatre objectifs cardinaux : la création de valeur, la souveraineté, l’empreinte environnementale et la cohésion sociale et territoriale. »
Pourtant, la période post-Covid a représenté une parenthèse encourageante : “On a connu un printemps de la réindustrialisation, avec des créations d’emplois inédites depuis vingt ans. Mais à l’été 2024, tous les signaux sont repassés au rouge.” La crise énergétique suite à la guerre en Ukraine et la fin du dispositif de France Relance en faveur de France 2030, ont brisé cet élan. « France 2030 a beaucoup focalisé sur l’innovation de rupture. C’est bien, mais le gros potentiel de réindustrialisation c’est les PMI et les ETI qui sont ancrées dans les territoires. Ils ne vont pas faire l’ordinateur quantique, ce n’est pas leur rôle mais ils doivent se moderniser et on les a un peu laissé de côté avec France 2030. Résultat : alors que la France avait juste commencé à recréer des emplois industriels, une nouvelle phase de désindustrialisation s’est engagée.
« il y a des leviers qu’on peut activer intelligemment »
Malgré un contexte économique et politique tendu à l’international comme dans l’Hexagone, il reste persuadé que la France a des solutions à sa disposition. « Le contexte est difficile mais il y a des solutions qui pourraient libérer le potentiel de nos territoires. Par exemple, en orientant notre commande publique vers plus de made in France, sans pour autant changer les textes européens, nous pourrions réaliser 15 milliards d’euros en plus de chiffre d’affaires manufacturier. Sur la formation, on a suffisamment d’argent, mais on ne forme pas les gens aux bonnes compétences, au bon endroit, donc c’est inefficace. Sur le foncier, nous sommes le pays le moins dense d’Europe mais aujourd’hui, il y a + de 90 % d’intercommunalités qui disent ne plus avoir suffisamment de foncier pour développer de l’activité industrielle d’ici à 2030. Je ne dis pas qu’il faut faire n’importe quoi en la matière, mais 2030 c’est demain en aménagement du territoire.»
Optimiste sur le potentiel industriel français, il constate cependant, un peu désabusé, que la « marche avant » n’a toujours pas été enclenchée : « il y a des leviers que nous pouvons activer intelligemment, dans le respect des contraintes budgétaires, dans le respect d’une sobriété foncière, mais ce qui est problématique, c’est que nous ne le faisons pas. Nous sommes responsables de nos propres désordres..»
Un ancrage territorial essentiel
Olivier Lluansi défend l’idée qu’une industrie ne fonctionne que si elle est ancrée dans son territoire. De ses expériences passées, il tire une conclusion claire : « le succès d’une usine ne dépend pas que de son secteur, ni même de son positionnement au sein de ce secteur, mais aussi du lieu dans lequel elle est implantée et de comment elle arrive à interagir avec son territoire et son écosystème.»
L’industrie est pourvoyeuse d’emploi certes, mais c’est aussi un facteur de lien social et de fierté locale qui doit s’intégrer dans un tableau national plus large et composé de toutes les spécificités du territoire. « Les gilets jaunes nous ont rappelé qu’un territoire qui ne se sent plus utile économiquement finit par ne plus se sentir partie prenante de la nation. C’est important que chacun de nos composantes territoriales ait l’impression de contribuer à la grande Histoire de la France ou de l’Europe. Et donc montrer comment un territoire contribue à une trajectoire économique et peut en être fier me semble absolument essentiel. Nous en avons pourtant totalement perdu l’habitude. Il y a des pépites partout, des entreprises qui font vivre la fierté collective. Les raconter, c’est déjà réindustrialiser nos imaginaires. »
Une renaissance industrielle française aux allures de tableau pointilliste
Dans ses livres, Olivier Lluansi préfère parler de “renaissance” industrielle plutôt que de “révolution”, et le mot n’est pas choisi au hasard. “Une révolution, c’est violent, c’est une prise de pouvoir et puis il y a aussi l’idée de renverser la table. Or, dans le monde industriel, on a besoin des savoir-faire anciens pour faire l’industrie nouvelle, il y a un continuum qui est indispensable à la réussite. L’industrie d’après-demain a besoin du socle industriel d’aujourd’hui.”
La table ronde de la Biennale de Tulle sur « Les imaginaires passés et futurs de l’industrie » sera l’occasion d’aborder enfin autrement la question industrielle. « Nous osons enfin reparler de l’image de l’industrie ». Aujourd’hui, les diagnostics et les solutions sont connus et partagés, « il y a une forme de consensus, mais on n’a pas réussi à enclencher ». Et ce blocage tient, selon lui, en grande partie à l’absence d’un récit partagé.
« Si on veut tous tirer dans le même sens, il faut qu’on partage un imaginaire », dit-il, mais « La « start-up nation » n’est pas un imaginaire qui est adapté à la France, à notre histoire et à nos territoires et à notre diversité.» Pour façonner cet imaginaire collectif qui nous fait tant défaut, il ne croit plus à une grande idée descendante, « cette pensée universelle à la française », mais plutôt à « plein de petites visions très enthousiasmantes, très inspirantes qui peuvent naître à côté de chez soi. Je pense que cet imaginaire va naître d’une multitude de récits territoriaux, autour de chef(fe)s d’entreprise, d’équipes, de coopératives qui vont avoir différentes histoires à nous raconter et qui finiront par donner une vision d’ensemble, comme un tableau pointilliste. »
A l’image de ces cartes de France des « productions locales » qui ornaient jadis les murs des salles de classes, Olivier Lluansi rêve donc d’une renaissance industrielle qui se décline au gré des territoires, avec leurs spécificités, leurs atouts et fiertés, mais permet de composer un grand tableau cohérent.« Est-ce que avec des points de couleur on fait un dessin qui a du sens globalement ? Est-ce qu’on peut faire un récit national avec un ensemble de juxtaposition de récits territoriaux ? Notre culture politique elle nous dit que non, mais il y a plein de pays qui réussissent à le faire.»
Rappel : pour plus d’informations sur la « Biennale européenne d’histoire locale » de Tulle, rendez-vous sur le site biennale-tulle.fr